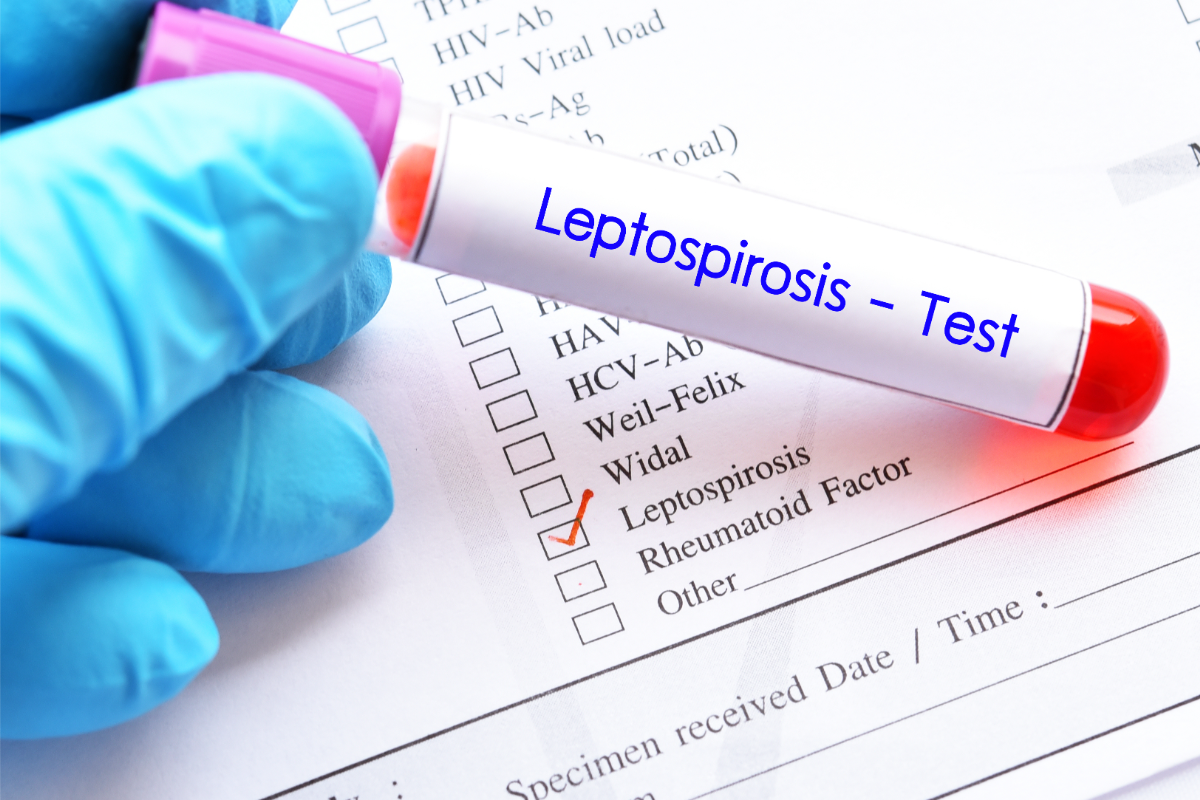La leptospirose est une maladie infectieuse d’origine bactérienne qui touche principalement les animaux, mais qui peut également affecter les humains. Provoquée par des bactéries du genre Leptospira, cette zoonose est souvent sous-estimée malgré ses implications potentiellement graves sur la santé publique. Elle se transmet principalement par l’exposition à l’eau ou à un sol contaminé par l’urine d’animaux infectés, particulièrement les rongeurs.
Quelle est la bactérie responsable ?
Les leptospiroses sont des maladies infectieuses de gravité variable, dues à des bactéries du genre Leptospira, de l’ordre des spirochètes. Les bactéries pathogènes du genre Leptospira incluent plusieurs espèces, dont Leptospira interrogans, pour laquelle il existe plus de 250 variétés appelées sérovars. Les plus fréquents en France métropolitaine sont L. icterohaemorrhagiae, L. australis, L. sejroe, et L. grippotyphosa.
Ce sont des anthropozoonoses, maladies communes aux humains et aux animaux (mammifères). Les principaux réservoirs sont les rongeurs sauvages (porteurs sains), suivis des chiens et des animaux de rente (porcs, chevaux, bovins). Le genre Leptospira comprend également des espèces saprophytes, non pathogènes, comme L. biflexa, qui vivent dans le sol et l’eau douce et n’infestent pas les animaux. Au cours de l’évolution, certaines espèces se sont adaptées aux tubules rénaux des mammifères. Elles provoquent des leptospiroses chez l’homme et les animaux domestiques.
Leptospira interrogans est l’agent pathogène responsable de la leptospirose. En 2017, le genre Leptospira comptait 22 espèces, dont 10 pathogènes, et plus de 300 sérovars répartis en 24 sérogroupes. Les sérogroupes les plus importants sont icterohaemorragiae, canicola, pomona, australis, grippotyphosa, hyos, et sejroe. Cette diversité complique la conception de vaccins efficaces contre toutes les leptospiroses.
La bactérie Leptospira mesure de 6 à 20 micromètres de long et 0,1 micromètre de diamètre. Elle est aérobie et se cultive lentement à 27-30°C sur des milieux spéciaux. Elle apparaît comme un filament spiralé, flexible et mobile, avec des extrémités en crochet, et un endoflagelle terminal constitué d’une paire de flagelles périplasmatiques. Cette structure lui confère mobilité et rapidité. Cela facilite sa diffusion tissulaire et sa capacité à échapper aux mécanismes de défense immunitaires comme la phagocytose.
Depuis le début du XXIe siècle, une nouvelle classification basée sur le génome tend à compléter la classification traditionnelle basée sur les antigènes.
Comment se traduit la maladie chez l’animal ?
La leptospirose est une maladie infectieuse causée par des bactéries pathogènes du genre Leptospira. Elle est répandue mondialement, avec une incidence particulièrement élevée dans les zones tropicales. En Europe, la situation varie selon les pays.
Tous les mammifères peuvent être infectés par les leptospires. Les espèces sensibles, comme les animaux de rente, de compagnie et de loisirs, peuvent développer des maladies, le chien étant l’espèce la plus sensible. Les espèces peu ou pas sensibles, principalement les rongeurs, peuvent excréter les bactéries via leurs urines. Certaines espèces réceptives, telles que les castors et les renards, peuvent héberger les bactéries sans que leur sensibilité soit bien connue.
La transmission se fait principalement par contact des muqueuses ou de la peau lésée avec de l’eau douce, du sol ou un environnement contaminé par les urines d’animaux infectés. Les leptospires peuvent survivre plusieurs semaines dans l’eau douce. La transmission peut également se produire via des fluides biologiques contaminés, principalement l’urine des animaux infectés.
Les signes cliniques varient selon les espèces. Chez les chiens, les atteintes du foie et des reins peuvent provoquer la mort en quelques jours sans traitement. Les chevaux, bovins et porcs peuvent présenter des troubles de la reproduction. Les rongeurs sont généralement asymptomatiques, excepté les castors, hamsters et cochons d’Inde, mais sont des porteurs rénaux.
Chez les chiens, la leptospirose est principalement due à Leptospira canicola et L. interrogans. Les chiens infectés présentent rapidement de la fièvre et des vomissements. Le traitement repose sur l’antibiothérapie. Un vaccin vétérinaire est disponible, bien que son efficacité puisse être limitée contre certaines leptospiroses.
Chez les bovins et ovins, la leptospirose peut entraîner des pertes économiques pour les éleveurs en affectant la reproduction et la production de lait. Chez les chevaux, des complications oculaires peuvent survenir.
Quel est son mode de transmission ?
La transmission de la leptospirose se fait par contact des muqueuses ou de la peau lésée. Elle survient principalement lors de l’exposition à de l’eau douce, du sol ou un environnement contaminé par les urines d’animaux infectés, où les leptospires peuvent survivre plusieurs semaines. Les fluides biologiques contaminés, notamment l’urine, sont également des vecteurs de transmission.
Les activités professionnelles à risque incluent les travaux au contact des eaux douces ou des sols humides souillés par des urines de rongeurs (rats, ragondins, rats musqués et souris). Les égoutiers, le personnel de stations d’épuration, les professionnels de l’entretien des berges, les pisciculteurs, les gardes-pêches, et les travailleurs en milieu aquatique sont particulièrement exposés. De plus, les éleveurs, vétérinaires, ouvriers d’abattoirs, équarrisseurs, et animaliers en contact avec des rongeurs domestiques peuvent également être à risque.
La porte d’entrée de la bactérie est généralement cutanée. Elle semble facilitée par une effraction ou une peau ramollie par un séjour prolongé dans l’eau. La contamination peut aussi se produire par les muqueuses par projection d’eau souillée dans la bouche, le nez ou les yeux. L’inhalation d’aérosols est moins fréquente. Les activités de loisir comme la baignade, la pêche, le kayak et le rafting augmentent également le risque de transmission.
Après pénétration cutanée ou muqueuse, les leptospires passent dans le sang et migrent dans tous les tissus. La durée d’incubation et la gravité de l’infection dépendent de la quantité de leptospires inoculée.
Les leptospires, présentes dans l’eau à la suite de déjections d’animaux contaminés, pénètrent dans l’organisme par des plaies, des érosions cutanées, les muqueuses, ou par inhalation. L’homme est un hôte occasionnel des leptospires pathogènes, qui impliquent un cycle entre les animaux sauvages et domestiques.
Comment se manifeste la leptospirose chez l’Homme ?
L’incubation de la leptospirose varie de 1 à 3 semaines, habituellement entre 7 et 14 jours. La maladie présente de nombreuses formes cliniques. Ces dernières peuvent aller du syndrome grippal à l’atteinte multiviscérale avec syndrome hémorragique, rendant le diagnostic difficile. Le taux de létalité est de 5 % à 20 % en l’absence de traitement ou en cas de retard. La leptospirose est typiquement biphasique, mais peut parfois être monophasique et fulminante. Le diagnostic est plus probable en été, avec une exposition professionnelle ou de loisir en eaux douces ou sur les berges.
Les deux phases de la leptospirose
La leptospirose débute par une phase septicémique, où les leptospires se multiplient dans le sang et endommagent les petits vaisseaux par vascularite. Cela provoque une fièvre sévère avec douleurs diffuses. Ensuite, les leptospires se fixent dans divers organes (foie, rein, cerveau, cœur), rendant le diagnostic difficile. Cette phase commence brutalement avec des céphalées, myalgies intenses, frissons, fièvre, toux, et parfois hémoptysie. Les yeux deviennent rouges habituellement vers le 3e ou 4e jour. La phase septicémique dure de 4 à 9 jours.
Après la phase septicémique, une phase immunitaire survient entre le 6e et le 12e jour, marquée par l’apparition des anticorps dans le sérum. Les symptômes réapparaissent, avec une fièvre renouvelée et des signes de méningite. Des atteintes oculaires comme l’iridocyclite, la névrite optique, et les neuropathies périphériques peuvent se manifester. Les complications pulmonaires peuvent être sévères en cas d’hémorragie pulmonaire. Cette phase dure généralement de 4 à 30 jours.
L’atteinte rénale entraîne une excrétion de leptospires par les urines, mais trop tardivement pour aider au diagnostic. Chez l’homme, il n’y a pas de porteur sain, et il n’est pas un réservoir de transmission.
En cas d’infection pendant la grossesse, la leptospirose peut entraîner une fausse couche, même pendant la convalescence. La maladie chez l’homme peut être sévère en l’absence de traitement, avec un taux de létalité de 5 % à 20 %. Les formes graves peuvent inclure une insuffisance rénale, des troubles neurologiques (convulsions, coma) et des hémorragies potentiellement mortelles.
Il est crucial de consulter un médecin en cas de fièvre dans les deux semaines suivant une baignade ou un loisir en eau douce, en signalant cette activité.
Forme classique : maladie de Weil
La leptospirose ictéro-hémorragique ou maladie de Weil est une forme clinique classique de la leptospirose. Elle associe un ictère et une atteinte rénale (hépatonéphrite) avec des troubles hémorragiques. Leptospira interrogans, principalement le sérovar icterohaemorrhagiae, cause la maladie, bien que d’autres sérovars soient possibles.
Autrefois considérée comme la forme la plus grave de leptospirose, les spécialistes voient désormais la maladie de Weil comme une forme plus habituelle et moins grave dans les pays développés.
Les manifestations cliniques varient en intensité. Dans la majorité des cas, elles sont peu graves, mais peuvent évoluer de façon imprévisible vers des troubles sévères avec une mortalité de plus de 10 %.
Le début est brutal avec un syndrome infectieux sévère (fièvre élevée, frissons, asthénie) et douloureux (céphalées, douleurs musculaires). Un ictère apparaît après 2 à 8 jours, atteignant son maximum en 2 jours, réalisant un « ictère flamboyant ». Cette phase dure environ 10 jours, suivie d’une accalmie et d’une possible rechute.
L’atteinte rénale, caractérisée par de l’albuminurie et une diminution de la production d’urine, peut évoluer vers une insuffisance rénale aiguë nécessitant une hémodialyse. Les troubles hémorragiques incluent des pétéchies, épistaxis, et saignements des gencives, avec une thrombopénie fréquente. Des hémorragies graves peuvent survenir au niveau des voies respiratoires, digestives et uro-génitales.
Des complications rares comme la méningite et des atteintes multiviscérales (cardio-vasculaires, pulmonaires, choc septique) peuvent nécessiter une réanimation spécifique. Le syndrome de Weil peut entraîner une fièvre, une jaunisse, une insuffisance rénale et des tendances hémorragiques. Les poumons et le cœur peuvent aussi être sévèrement affectés.
En l’absence de jaunisse, la guérison est complète. En présence d’ictère, la létalité est de 5 à 10 %, atteignant 40 % dans les cas graves, surtout chez les patients de plus de 60 ans. Le risque de décès augmente avec des complications telles que l’insuffisance rénale, respiratoire, et les hémorragies internes.
Forme pseudogrippale
La forme pseudogrippale de la leptospirose, représentant environ 80 % des cas, est plus fréquente que la forme classique. Le début de la maladie est brutal avec un état infectieux sévère : une fièvre dépassant 39 °C, des frissons, des céphalées, accompagnés de myalgies et de douleurs diffuses prédominant aux membres inférieurs, notamment des douleurs invalidantes des mollets, aggravées à la pression.
L’examen clinique peut révéler plusieurs signes distinctifs, dont une hémorragie conjonctivale, un herpès labial, et parfois une hépatomégalie douloureuse. Plus rarement, un exanthème peut apparaître sur le tronc. Cette phase initiale de la maladie dure de 3 à 7 jours, durant laquelle la fièvre se normalise progressivement.
En l’absence de traitement, une rechute peut survenir. Les symptômes initiaux réapparaissent, généralement moins intenses, mais s’accompagnent de signes méningés et de troubles neurologiques. Ces signes incluent une raideur de la nuque, des maux de tête sévères, et parfois des symptômes plus graves tels que des convulsions. Des complications oculaires peuvent aussi se manifester plus tard, notamment l’uvéite d’origine immunologique, causée par des auto-anticorps.
La phase initiale de la forme pseudogrippale est marquée par une forte fièvre, des douleurs musculaires sévères, des céphalées et des frissons. Ces symptômes peuvent imiter ceux de la grippe. Cela rend le diagnostic clinique difficile sans un historique d’exposition aux facteurs de risque de leptospirose.
La forme pseudogrippale de la leptospirose se caractérise par une présentation initiale sévère mais souvent non spécifique. Elle est ensuite suivie d’une possible rechute avec des complications neurologiques et oculaires. Cette forme anictérique de la leptospirose est la plus courante. Elle représente la majorité des cas, et nécessite une vigilance particulière pour un diagnostic et un traitement précoces.
Autres formes
Quel est le traitement adapté ?
Le traitement de référence de la leptospirose fait appel à un antibiotique de la famille des pénicillines (Pénicilline G ou ampicilline) ou à une cycline comme la doxycycline. Il s’agit d’une antibiothérapie probabiliste à débuter précocement, d’une durée de 7 à 10 jours. Cette antibiothérapie précoce a presque éliminé les formes chroniques graves, notamment les complications oculaires auto-immunes.
En cas de complications viscérales et métaboliques, des méthodes de réanimation peuvent être nécessaires, comme la dialyse pour une insuffisance rénale persistante. Une réaction de Jarisch-Herxheimer, due à la lyse des spirochètes, est fréquente après le début du traitement.
Le patient récupère en 5 à 6 semaines si la maladie s’avère modérée. Cependant, des bactéries peuvent encore être présentes dans les urines plusieurs semaines après la disparition des symptômes. Les formes graves de leptospirose ont un taux de mortalité supérieur à 10 % dans le monde, mais dans les pays avec des infrastructures médicales modernes, la mortalité est proche de zéro.
Pour les formes graves, les médecins administrent des corticoïdes, bien que leur efficacité suscite des débats. Ils administrent le traitement antibiotique précocement pour une efficacité maximale. L’isolement ne s’impose pas, mais on doit prendre des précautions pour l’élimination des urines.
Le traitement des formes graves nécessite une hospitalisation avec réanimation médicale et antibiotiques administrés dès que possible. Les céphalosporines de troisième génération (ceftriaxone et céfotaxime) et l’azithromycine sont les traitements de première intention. Les cyclines peuvent être proposées en cas d’allergie. Les leptospires sont habituellement sensibles aux β-lactamines, macrolides et cyclines.
Un vaccin (SPIROLEPT®) est disponible pour la prophylaxie de la leptospirose due au sérogroupe Icterohaemorrhagiae chez les adultes exposés à un risque élevé.
Quels sont les moyens de prévention ?
Les actions au niveau du réservoir comprennent :
- Lutte contre les rongeurs : dératisation, élimination des sources de nourriture et d’abris, gestion des détritus dans des contenants fermés, conception des locaux.
- Gestion de l’environnement : drainage des prairies humides, élimination des eaux stagnantes.
- Surveillance sanitaire : déclaration et gestion des avortements dans les élevages.
- Isolement et traitement des animaux malades : si conservation des animaux, traitement curatif.
- Vaccination animale : adaptée aux espèces concernées.
Pour limiter la transmission, il faut :
- Limiter les contacts avec des eaux douces dans les zones fréquentées par des rongeurs.
- Éviter tout contact direct avec un animal sauvage, vivant ou mort.
- Organisation des chantiers : repérage des rongeurs et des zones humides si travail en milieu humide ou infesté.
- Transport sécurisé : des déchets et cadavres dans des contenants étanches et étiquetés.
- Nettoyage et désinfection : des sites contaminés et des matériels de service réutilisables avec un bactéricide autorisé.
- Moyens d’hygiène : armoires-vestiaires distinctes pour vêtements de ville et de travail, eau potable, savon, moyens d’essuyage à usage unique, et trousse de première urgence définie avec le médecin du travail.
- Information dès l’embauche et renouvelée régulièrement
- En laboratoire, respecter les bonnes pratiques conformément à la réglementation en vigueur.
On compte pour la prévention individuelle sur :
- Équipements de protection individuelle : gants résistants et étanches, bottes ou cuissardes, combinaison imperméable, lunettes de protection selon l’activité.
- Le respect des consignes d’hygiène
Les laboratoires en France préparent le vaccin SPIROLEPT® à partir de la bactérie L. interrogans sérovar Icterohaemorrhagiae inactivée. Ce vaccin cible les adultes exposés à un risque élevé. Le schéma vaccinal comprend deux injections à 15 jours d’intervalle, un rappel 4 à 6 mois plus tard, puis tous les 2 ans si l’exposition persiste.
En médecine vétérinaire, les chiens sont généralement vaccinés contre quatre sérogroupes : L. Canicola, L. Icterohaemorrhagiae, L. Australis, et L. Grippotyphosa.
Quelques données épidémiologiques…
La leptospirose n’est pas une maladie animale à surveillance obligatoire (Règlement 2016/429). En revanche, elle constitue une maladie humaine à déclaration obligatoire. Les autorités reconnaissent la leptospirose comme maladie professionnelle indemnisable selon les tableaux n°5 du régime agricole et n°19 du régime général. Les autorités classent tous les sérovars de Leptospira interrogans dans le groupe 2 (article R.4421-3 du code du travail, arrêté du 16 novembre 2021).
La leptospirose est une maladie à répartition mondiale, avec une incidence particulièrement élevée dans les régions tropicales. En France métropolitaine, elle touche environ 600 personnes chaque année (0,4 à 1/100 000 habitants). L’incidence est 50 à 100 fois plus élevée dans les régions tropicales. On estime à plus d’un million le nombre de cas sévères par an dans le monde, avec un taux de mortalité supérieur à 10 %. La maladie connaît une saisonnalité marquée, avec des pics pendant la saison des pluies dans les régions tropicales et en été/automne dans les pays tempérés.
Certaines professions (agriculteurs, éleveurs, égoutiers, éboueurs) et les activités de loisirs nautiques (baignade, canoë, kayak, pêche, chasse, canyoning) présentent des risques accrus.
L’épidémiologie varie selon les écosystèmes et les conditions de vie. En France, le nombre de cas est passé de 300 à environ 600 par an depuis 2014. Les régions du sud et de la Franche-Comté sont les plus touchées. Dans les départements d’Outre-Mer, l’incidence est 10 à 80 fois plus élevée qu’en Métropole.
Les raisons de cette émergence sont multiples : réchauffement climatique, augmentation des populations de rongeurs, et activités à risque. Le signalement systématique des cas de leptospirose depuis août 2023 vise à mieux évaluer la maladie, identifier les populations à risque, et mettre en œuvre des mesures de contrôle adaptées.